"Je suis oiseau voyez mes ailes. Je suis souris vivent les rats". (La Fontaine, fable "La Chauve-souris et les deux Belettes")
D'un naturel optimiste, on imagine volontiers, écrivant à la veille du 70e anniversaire du pacte germano-soviétique, toutes les vérités que nos médiats ne manqueront pas de rappeler autour de ce 23 août 1939. On pense donc aux innombrables et chaleureuses recensions qu'aurait méritées le film de Wajda "Katyn". N'ayant pas été écrites, encore moins publiées par les gros journaux parisiens, elles demeurent en réserve pour cette occasion. Au talent près du cinéaste, l'information de base ne diffère pas.
Quant à moi, m'étant exprimé sur le partage soviéto-hitlérien de la Pologne de 1939, je ne puis ici que renvoyer à l'expression précédente de mes sentiments invariants. (1)
Les lignes qui suivent chercheront seulement à compléter, aujourd'hui, tant soit peu l'information de mes lecteurs, auditeurs, amis et concitoyens, autour d'un aspect particulier de cette fresque tragique de la Seconde guerre mondiale, au travers de la diplomatie turque, et de l'étonnante complaisance de l'occident à son égard. On peut admirer techniquement la continuité de cet État oriental (2).
En occident, il existe une abondante documentation sur tous les événements que nous évoquerons. Physiquement libres d'y recourir, généralement capables de la comprendre, les historiens et commentateurs agréés ne méritent aucune excuse, deux générations plus tard, quand ils se refusent à tenir compte des faits. La nullité intrinsèque des gens qui se disent journalistes ne saurait, non plus, tenir lieu de justification à leur silence servile. Car, en somme, pour eux, dans sa froideur impavide et sélective, la méthode de l'Histoire de la Seconde guerre mondiale de Sir Basil Lidell Hart, monumentale mais partiale et partielle (3), continue de faire secrètement autorité. Voilà un domaine où les choix arbitraires ne se discutent pas.
Pour les bons esprits, l'alliance entre l'occident et l'URSS paraît aller rétrospectivement de soi, et tous les incidents de parcours n'en demeurent que points de détail.
Commençons donc par rappeler que l'alliance initiale entre cette même Union Soviétique, dirigée par Staline, et l'Allemagne nazie a bel et bien fonctionné, à balles réelles, à chaud et à sable, entre 1939 et 1941.
Rendant possible la mainmise de Hitler sur la moitié du continent, elle porte la responsabilité de toutes les conséquences qu'elle a entraînées. Évoquons notamment l'horreur la plus couramment citée : la déportation et l'extermination des Juifs de l'Europe occupée. Tautologie à mémoriser : sans cette occupation, rendue elle-même possible par l'alliance de Staline, le génocide n'aurait jamais eu lieu sur une telle échelle. Souvenons-nous bien aussi qu'on ne sache pas que le mouvement communiste international ait rompu le 22 juin 1941 l'accord de 1939 scrupuleusement respecté par lui. Mais, à la grande surprise du secrétaire général du parti le génial Staline, son déloyal partenaire déclencha l'Opération Barbarossa. On n'est jamais trahi que par les siens.
On ne doit donc pas s'étonner, la réalité globale de cette alliance étant systématiquement occultée, que ni ses causes lointaines, ni ses conséquences particulières ne soient ordinairement tenues pour dignes d'intérêt. Ainsi, devant la rareté des commentaires sur le film Katyn, sachant le silence étouffant le souvenir de l'héroïque guerre d'hiver des Finlandais, mesurant la réprobation dont une propagande post-soviétique continue de poursuivre la résistance au stalinisme de peuples entiers, comment s'étonner de l'obscurité qui entoure, aujourd'hui encore la ligne suivie par le gouvernement turc pendant la Seconde guerre mondiale. Ceux-là même qui feignent de le considérer comme européen, s'obstinent paradoxalement, à ne rien vouloir connaître de l'Histoire contemporaine de cet État.
Ce 19 septembre, on pourra commémorer le 70e anniversaire de la jonction entre les armées de Staline et de Hitler à Brest-Litovsk. Gageons que l'on demeurera généralement plutôt sobre sur ce point oublié.
Les événements périphériques n'en passeront que plus aisément à la trappe.
Varsovie tombe le 27 septembre. Le 28 septembre est signé le traité d'amitié germano-soviétique scellant le partage de la Pologne entre hitlériens et staliniens.
Il se trouve que le même jour exactement on paraphait le traité anglo-franco-turc d'Ankara.
Or les historiens ont pris l'habitude de dater du 19 octobre cet accord tripartite: mais il s'agit de la date de ratification du document. La négociation, préparée de longtemps par les trois diplomaties, se déroule en fait exactement entre la signature de l'alliance entre l'URSS et le Reich, et la prise de la capitale polonaise.
Les papiers Hoppenot (4) en fournissent l'avancée en détail, mais on peut aussi trouver les reflets de la face émergée de cet iceberg dans n'importe quelle collection de l'Illustration, avec photo pleine page du plénipotentiaire français, le général Weygand. On voit jour après jour la progression des tractations. Le légendaire "sauveur de la Pologne" en 1920 (5), se trouve à Ankara en septembre 1939.
À ce même moment la diplomatie turque est dirigée par un personnage essentiel de l'Histoire contemporaine de son pays, Mehmet Sükrü Saradjoglou (6). En juillet 1942, au décès du président du conseil, le Dr Refik Saydam, il prendra les rênes du gouvernement. Et il les conservera jusqu'en août 1946. Les curieux trouveront en annexe (7) de cette chronique le texte publié en 1946 du rapport secret de Von Papen à la Wilhelmstraße relatant leur entretien à Ankara en août 1942.
Le comportement de la Turquie s'est fondé, pendant toute la durée de la guerre, sur une pratique de la "neutralité active" qui se nomme aussi "double jeu".
Dans la fable de La Fontaine "La Chauve-souris et les deux Belettes" la première déclare ainsi : "Je suis oiseau voyez mes ailes. Je suis souris vivent les rats".
Or, à la différence du théoricien et praticien français oublié de ce même "double jeu", Marcel Bucard, qui sera fusillé en 1945, la mémoire de l'habile Saradjoglou s'immortalise dans la pierre, ou plutôt dans le béton précontraint du stade de 50 000 places qui porte son nom et accueille à Istanbul l'équipe de podosphère de Fenerbahce. En effet, dès le 23 février 1945, 10 jours après le bombardement de Dresde et appliquant les dispositions du traité signé en 1939 avec la France et la Grande-Bretagne son gouvernement déclara courageusement la guerre à ce qui restait des puissances de l'Axe.
Qu'on ne se méprenne pas cependant : si Saradjoglou a pu chercher à tromper les Allemands, et notamment l'ambassadeur Von Papen, son propos reposait sur la volonté d'observer la ligne constante du kémalisme. Le fondement en est posé par l'accord soviéto-turc de 1921. Celui-ci avait été théorisé au sein de l'Internationale communiste dès 1920 par Radek et par la conférence de Bakou. Dans la pratique, le soutien léniniste avait permis la victoire définitive de Mustafa Kémal en 1922. Les communistes s'étaient partagé l'Asie mineure et le Caucase avec les kémalistes en 1920-1922 comme ils se partageront l'Europe orientale avec les hitlériens en 1939-1940. Aujourd'hui encore dans la Mémoire officielle de l'État turc on appelle cela guerre de libération. Il s'agit du premier acte du tiers-mondisme.
Ainsi avaient été détruits en 1921 les trois États indépendants du Sud Caucase : l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Géorgie. Le 31 mai, l’Azerbaïdjan est occupé par la 11e Armée rouge. Quatre mois plus tard, l’Arménie doit céder la moitié de son territoire à l’envahisseur turc, le reste passant sous le contrôle de l’Armée rouge. Quant au dernier pays, la Géorgie, bastion occidental entre kémalistes et soviétiques, il tombe à son tour face au projet soviéto-turc pour le Caucase. Les populations grecques d'Asie mineure (Smyrne et son hinterland, Trébizonde et la république du Pont) seront symétriquement éliminées par la "grande catastrophe" de 1922. Au cours de la même année les 3 pays sud-caucasiens sont inclus dans une prétendue "République socialiste fédérative soviétique de Transcaucasie".
Certes, tant qu'il demeura partagé entre l'influence des deux régimes totalitaires de Berlin et de Moscou, le gouvernement Saradjoglou saura faire preuve d'éclectisme. Ainsi au premier il empruntera un souci de liquidation des minorités auquel il ajoutera une notion fiscale inscrite dans la loi 4305 du 12 novembre 1942 établissant un impôt exceptionnel sur le capital au taux différencié selon la religion des contribuables : les musulmans (groupe M) payeront 5 % ; les juifs "dönmeh" convertis à l'islam (groupe D) 20 % ; les chrétiens et les non-musulmans (groupe G comme "giaours" infidèles) 50 % et jusqu'à 236 %; les 8 000 personnes qui ne purent payer furent envoyées en camp de travail près d'Erzurum. On n'a jamais entendu dire ni que le gouvernement d'Ankara ait jamais fait repentance de cette législation discriminatire, ni qu'il ait accepté d'en dédommager les victimes, ni que l'on envisage de débaptiser le stade Saradjoglou. Les critères de Copenhague ne posent d'ailleurs aucune de ces conditions.
En feuilletant les papiers jaunis de septembre 1939, on découvre que Saradjoglou s'était rendu en URSS pour examiner les conséquences du pacte Molotov-Ribbentrop. Il publia une déclaration datée d'Odessa le 24 septembre. À cette date Weygand se trouvait en Turquie, représentant la IIIe république. Une chose préoccupait Saradjoglou. En son absence, mais en son nom, on allait traiter avec les occidentaux. Cet accord devait se révéler extrêmement profitable pour son pays. Le projet comportait l'obligation future d'entrer en guerre (ce que la Turquie fit, en février 1945 comme indiqué plus haut). Mais il fallait ne pas contrarier en quoi que ce soit les accords fondamentaux soviéto-turcs de 1921. Or cette position ne résultait aucunement du secret diplomatique : on la trouve clairement exposée dans "l'Illustration" qui n'y voit rien à redire, lors même que l'URSS s'apprête à dépecer la Pologne, liée à la France et à l'Angleterre, mais aussi la Roumanie, liée à Ankara par les fragiles et incompréhensibles accords balkaniques.
Or on doit se représenter que l'entrée en guerre, contre l'Allemagne mais très tardivement, s'échangeait contre l'annexion par la république kémaliste d'un territoire appelé depuis septembre 1938 république du Hatay. La France avait accepté en juin de le céder aux Turcs comme gage unilatéral d'amitié. Simplement cette actuelle province turque avait, jusqu'en 1936, fait partie de la Syrie confiée à la France puissance mandataire au lendemain de la première guerre mondiale sous le nom de sandjak d'Alexandrette. Cette province constitue aujourd'hui encore une pièce du contentieux turco-syrien. À l'époque, le recensement français donnait sur 220 000 habitants, seulement 85 000 Turcs contre 108 000 Syriens (62 000 alaouites, 24 000 chrétiens et 22 000 sunnites), plus 25 000 Arméniens, 5 000 Kurdes et 1 000 Circassiens. Ce petit district allait donc être abandonné, au mépris du droit des gens, contre l'avis de ses habitants dans le but de faire de la Turquie une alliée.
Or, cette générosité, à sens unique, si bien conseillée par l'Empire britannique, qui lui-même ne cédait rien, se révélait aussi illusoire que déshonorante. La diplomatie turque de la chauve-souris disait aux démocrates occidentaux : "je partage vos valeurs" ; aux puissances totalitaires elle déclarait admirer leurs belles réussites. Toujours : "Je suis oiseau voyez mes ailes. Je suis souris vivent les rats"…
Aujourd'hui elle tient le même discours à l'Union européenne et à l'Organisation de la Conférence islamique auxquelles elle prétend appartenir simultanément. Encore et toujours : "Je suis oiseau voyez mes ailes. Je suis souris vivent les rats".
Car la recette constante de la politique extérieure d'Ankara plus encore que celle de la Sublime Porte, consiste à ne jamais contracter quelque chose qui ressemble à une alliance permanente et générale. Elle ne conclut que des accords ponctuels, limités dans le temps. Strictement souverainiste et jacobine, elle ne peut donc s'identifier à une communauté supranationale, à l'Europe moins qu'aucune autre. Pour cette raison et pour un certain nombre d'autres, on ne peut que récuser la candidature de ce pays à l'Union européenne.
Apostilles
- cf L'Insolent des 8 avril Katyn un film magnifique de Wajda et 9 avril Katyn le poids historique du mensonge et du crime.
- Soulignons qu'il dispose de traditions diplomatiques plus anciennement ininterrompues que celles de l'Angleterre. Ce qui, chez celle-ci remonte à Élizabeth Ire et surtout à Cromwell (XVIIe siècle) s'enracine en Turquie dans un tuf déjà riche et puissant à l'époque de la prise de Constantinople (XVe siècle) dont la Sublime Porte n'a jamais dédaigné non plus de gérer, en partie, l'héritage. À côté de cela, la France, dont chacune des ruptures historiques successives, en 1792, en 1815, en 1879, en 1944, et enfin la décolonisation, a lobotomisé l'intelligence officielle, fait figure d'une enfant naïve et docile.Il devrait aller de soi que la Chine, autrement dit la "république populaire" fondée en 1949, souvent présentée pour État millénaire, supporte encore moins la comparaison : ses élites n'ont de l'Étranger qu'une vision complètement caricaturale et une information à peine supérieure à celle de l'Américain moyen.
- Ce qui figure dans les 729 pages lumineuses de l'édition française passionnera certainement le lecteur mais on s'étonnera aussi de ce à quoi l'auteur ne consacre pas une seule ligne.
- Henri Hoppenot, diplomate français qui rallia la France libre, fit don en 1978 de ses dossiers aux Archives Diplomatiques où ils sont classés à la rubrique "Papiers d'envoyés".
- Le général Weygand fut, entre les deux guerres, considéré comme le "sauveur de la Pologne" par les Français, aux yeux des Polonais le vainqueur de la guerre polono-soviétique s'appelait Pilsudski.
- Mehmet Sükrü Saradjoglou (1887-1953) ancien cadre jeune-turc, siégea dans tous les gouvernements kémalistes de 1924 à 1946. Il présidera jusqu'en 1950 le club de Fenerbahce, et mourra dans son lit en 1953. On orthographiera de préférence à l'ancienne manière, puisqu'elle existe, car elle se révèle plus proche en français de la prononciation du phonème turc. La graphie "Saracoglu", agrémentée de signes diacritiques inconnus de l'orthographe française, prête trop à confusion.
- cf. texte du Rapport secret de Von Papen publié en 1946.
JG Malliarakis




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg




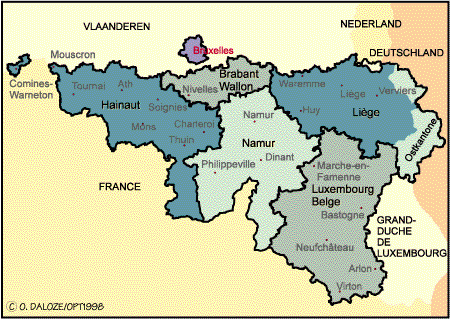

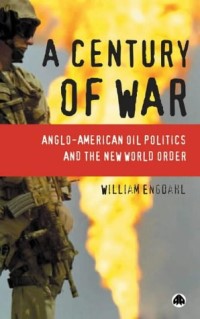

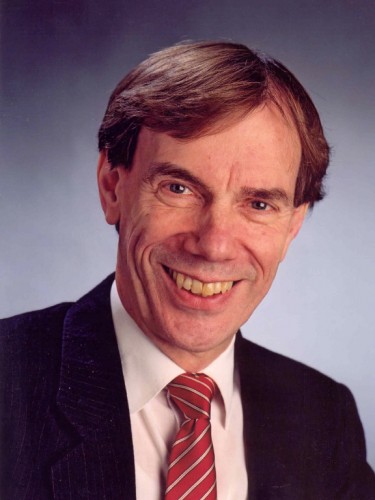


 DI F. WILLIAM ENGDAHL - Ex:
DI F. WILLIAM ENGDAHL - Ex: Voici l'analyse des résultats des élections européennes que nous a adressé notre ami Coclés :
Voici l'analyse des résultats des élections européennes que nous a adressé notre ami Coclés :


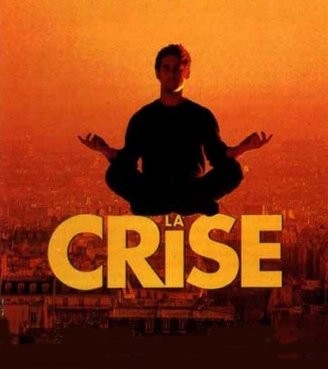

 C’est Jean-Luc Mélenchon qui a le mieux commenté les résultats de cette élection européenne : les Français ne veulent pas de cette Europe-là. Cette Europe en question, c’est celle, technocratique, de Bruxelles ou de Strasbourg sur laquelle les Européens n’ont aucune prise. C’est une Europe du fric aux mains des lobbies, une Europe qui se gausse des peuples et de la personnalité de chacun d’entre eux. C’est une Europe sans conscience politique, sans vision géopolitique et sous influence. Les députés européens sont des guignols impuissants et les eurodéputés français largement débordés par les Anglais ou les Allemands, qui ont formé depuis longtemps le personnel ad hoc. La France ne s’impose à Bruxelles – et encore, voir la crise du lait – qu’en situation de rupture et quand le pouvoir politique s’en mêle pour régler en général un problème de politique intérieure. De ce point de vue, nous ne sommes pas les seuls à dénoncer cette Europe-là. Ce reproche est d’ailleurs général sur le continent.
C’est Jean-Luc Mélenchon qui a le mieux commenté les résultats de cette élection européenne : les Français ne veulent pas de cette Europe-là. Cette Europe en question, c’est celle, technocratique, de Bruxelles ou de Strasbourg sur laquelle les Européens n’ont aucune prise. C’est une Europe du fric aux mains des lobbies, une Europe qui se gausse des peuples et de la personnalité de chacun d’entre eux. C’est une Europe sans conscience politique, sans vision géopolitique et sous influence. Les députés européens sont des guignols impuissants et les eurodéputés français largement débordés par les Anglais ou les Allemands, qui ont formé depuis longtemps le personnel ad hoc. La France ne s’impose à Bruxelles – et encore, voir la crise du lait – qu’en situation de rupture et quand le pouvoir politique s’en mêle pour régler en général un problème de politique intérieure. De ce point de vue, nous ne sommes pas les seuls à dénoncer cette Europe-là. Ce reproche est d’ailleurs général sur le continent.
 El manejo comunicacional oculta dos de esas verdades y hace blanco en la tercera, en los que resisten.
El manejo comunicacional oculta dos de esas verdades y hace blanco en la tercera, en los que resisten.